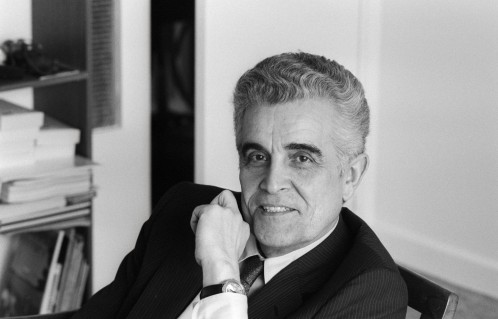I. Principales erreurs
1. Problème de formulation des hypothèses :
- Une hypothèse est composée au moins d’un sujet, d’un verbe, d’un complément et aussi d’une subordonnée (pour donner les conditions) ;
- Elles est forcément exprimée au conditionnel, temps des verbes ou sens des verbes (sembler, apparaître, paraître, croire, etc.) ;
- On doit y retrouver tous les concepts de la question, soit directement, soit indirectement. Ici, il fallait trouver la notion de la liberté et la notion de facilité, soit directement en utilisant le mot facile soit indirectement en utilisant le mot difficile ou en parlant de la notion d’effort.
- Il faut qu’elle soit crédible donc relativement concrète.
2. Il manque souvent une situation problème crédible, précise et concrète.
3. Oubli important à éviter
Le devoir oublie de définir la notion de facilité, et part sur un autre sujet en lien avec la liberté. Vous risquez le hors sujet, c’est-à-dire moins de 6/20.
4. Vous oubliez de définir le mot liberté :
- Le mot n’est jamais défini correctement, vous utilisez toujours un FAL = Faux Ami de la Liberté
- Vous définissez correctement la liberté au départ mais vous ne développez pas le sens de cette définition. Et plus on avance dans le devoir, plus on s’aperçoit qu’en réalité vous utilisez un FAL !
- Vous définissez correctement la liberté mais vous avez du mal à expliquer cette définition.
II. Conseils de rédaction :
Quand vous devez définir les concepts ou mettre en place des distinctions conceptuelles, suivez la structure suivante :
- Trouvez une formule qui résume la définition ;
- Expliquez cette formule en clarifiant les concepts utilisés dans cette définition. Il faut parfois plusieurs phrases pour réussir à le faire correctement.
- Prenez un exemple précis qui fasse bien comprendre ce que vous voulez dire au correcteur. C’est mieux si cette exemple est tiré de votre situation problème.
Quand vous présentez vos hypothèses et vos arguments, prenez bien le temps de les expliquer clairement. Le correcteur du bac ne connaîtra pas votre cours, il faut donc prendre le temps de le lui expliquer.
III. Qualité des définitions
Le devoir doit aller vers de plus en plus de pertinence, il va d’hypothèses de plus en plus crédibles, à une affirmation crédible et démontrée. C’est pourquoi, il vous faut choisir des définitions de plus en plus crédibles. Si vous utilsez une bonne définition de la liberté en H1, et que vous utilisez un FAL en H2, votre devoir perd en crédibilité. Dans ce cas, quand vous faites votre plan, il vaut mieux intervertir H1 et H2
IV. Utilisation des tragédies ou de romans, ou de films
Si vous choisissez d’utiliser des tragédies ou une autre référence littéraire ou cinématographique qui utilise l’art de la métaphore ou de la parabole, vous augmentez les chances d’avoir une très bonne note, si votre devoir est pertinent. Cependant, vous devez faire attention à transposer la métaphore à la vie courante. Sinon cela devient un discours de spécialiste qui oublie la réalité.
Je mesure l’effort requis pour utiliser une tragédie. Je ne pénalise donc pas trop étant donné l’effort fait.
V. Apprenez à bien définir la liberté
Revoyez bien le cours sur la liberté et surtout apprener à différencier la liberté réelle de ses FAL. Pas seulement intellectuellement, mais surtout dans votre existence, dans votre rapport à vos désirs personnels. Sinon, dans vos devoirs, intellectuellement vous définirez correctement la liberté, mais petit à petit votre plume va être influencée par vos désirs de FAL !
Autonomie ≠ autonomie de la volonté :
- Autonomie = indépendance totale (FAL), je me donne mes propres lois, peu importe ces lois. Cela peut être : je décide de tuer toutes les personnes qui m’ont fait du mal (loi de LAMEK).
- Autonomie de la volonté, chez Kant, c’est le fait de suivre sa raison pratique qui formule la loi que Kant appelle l’impératif catégorique.
VI. Attention aux formules toutes faites
Beaucoup utilisent la phrase : « Les hommes naissent libres et égaux » de la déclaration des droits de l’homme. Je vous appelle à ce sujet à la prudence :
- La phrase exacte c’est : « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Ce n’est pas la même chose.
- Il ne faut pas confondre le droit, c’est-à-dire ce qui devrait être, et la réalité, c’est-à-dire ce qui est. Cela correspond à peu près à la différence entre la théorie et la pratique.
- Ce n’est pas parce que l’on déclare quelque chose que forcément la réalité va changer. La déclaration des droits de l’homme est une proclamation par la parole écrite de quelque chose qui devrait être. Cela ne veut pas dire que cela suffise à transformer la réalité, même si cela peut aider.
- Autrement cela revient à se comporter vis à vis d’un texte ou d’un discours comme le magicien se comporte : il dit une formule et ABRACADABRA cela suffit à modifier la réalité.
- La réalité ne se modifie pas seulement avec des paroles, mêmes si elles peuvent avoir un impact réelle sur les consciences, mais d’abord avec des actes concrets.
- Par exemple, la déclaration de 1789 n’a pas aboli l’esclavage dans les colonies puisqu’il a fallu attendre 1848. Vous pouvez vérifier ce que je dis ici, en vous renseignant sur l’un des personnages clés de la révolution haïtienne : Toussaint Louverture.
- De plus 1793-1794 viennent bien montrer qu’une déclaration ne suffit pas, et qu’en son nom, on peut faire exactement l’inverse. Es-tu pour « liberté, égalité, fraternité » ? Si tu ne l’es pas alors tu meurs, peu importe si tu n’es qu’un bébé ! Voyez les colonnes infernales de Turreau de janvier 1794.
- Le cas de Philippe Égalité a de quoi laisser songeur, par ailleurs, sur ce droit soit disant partagé par tous. Le pauvre Duc d’Orléans ne pouvant accéder au trône de France, se mit à soutenir la cause des révolutionnaires qu’il a beaucoup aidée financièrement pour sa réussite, tout cela en espérant prendre la place sans doute sous le nom de président de son rival et cousin Louis XVI. Certes, il a terminé guillotiné en 1793, mais l’histoire de la révolution française nous montre malheureusement qu’au nom de « Liberté, Égalité, Fraternité », les révolutionnaires se sont eux-mêmes entre-déchirés et entre-tués !
- Petite remarque : les cas de Toussaint Louverture et de Philippe Égalité, nous prouvent qu’il ne suffit pas de proclamer un texte ou une devise pour transformer la réalité. C’est une sorte de preuve que la magie n’existe pas et que faire appel à elle, c’est prendre le risque de voir des violences sanguinaires arriver.