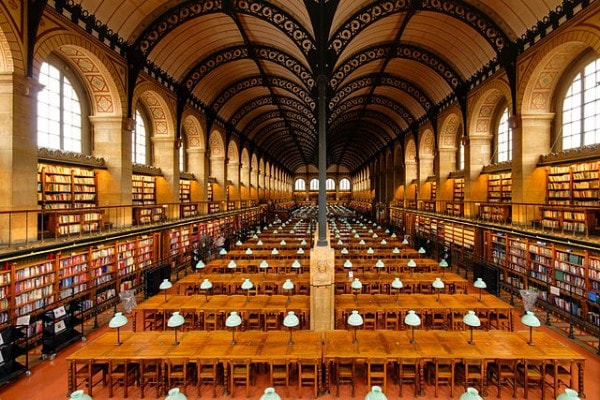À la fin du cours sur l’État et la Violence, nous abordons le concept de « Banalité du mal », développé par Hannah Arendt depuis son œuvre Eichmann à Jérusalem. Pour complèter la présentation que nous ferons en cours, je vous conseille de lire et d’écouter un certain nombre de sources qui permettent de se faire une meilleure idée au sujet de ce concept et surtout de la controverse qu’elle a soulevée :
- Dans une interview datant de 1973 réalisé par le journaliste français Roger Errera, elle revient sur de nombreux sujets de philosophie politique, particulièrement sur la distinction entre tyrannie, dictature et totalitarisme ;
- Puis dans cette même interview, elle revient sur son livre Eichmann à Jérusalem et sa controverse. On a là un témoignage précieux de ce qu’elle pense finalement. Je vous mettrai en ligne la transcription de cette partie de l’interview ;
- La revue Raison publique, a publié aussi deux articles qui permettent de mieux comprendre l’enjeu de la controverse qui revient d’ailleurs régulièrement. Le premier article précise le lien qu’il y a entre absence de pensée et banalité du mal. Il est écrit par la philosophe Aurore Mréjen ;
- Le second porte sur une controverse récente qui a eu lieu au sujet du lien entre la pensée d’Hannah Arendt et celle de Kant. L’article est écrit par Alain Renaut qui est un philosophe spécialiste de Kant et très reconnu par la République Française. Il est assez difficile à lire mais permet de mieux saisir la pensée de Hannah Arendt.
- La philosophe Chantal Delsol a publié sur le site de l’encyclopédie de l’Agora, un article faisant la comparaison entre la conception du mal chez Hannah Arendt et chez la philosophe française Simone Weil. Cet article a le mérite d’être très clair et synthétique.
Bonnes réflexions, ceci est un sujet important mais complexe tant il est facile de faire des erreurs d’interprétation concernant cette controverse qui a été parfois très médiatisée.
Bonnes réflexions.