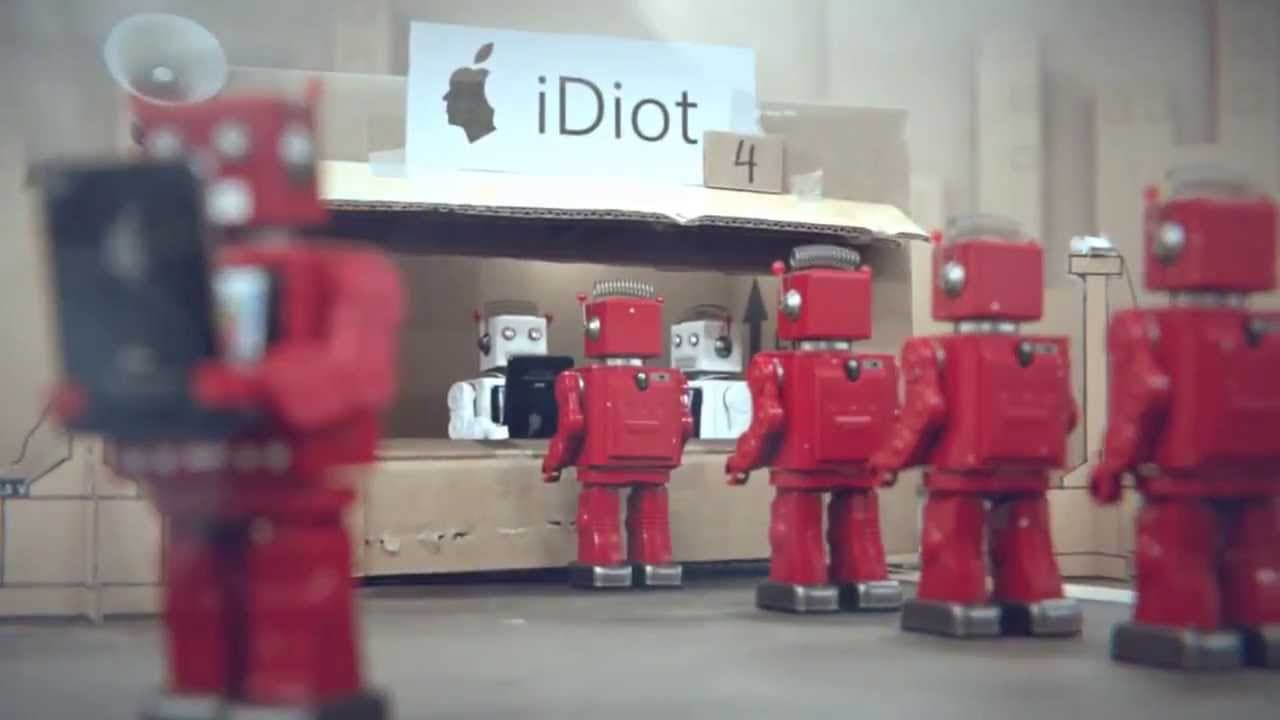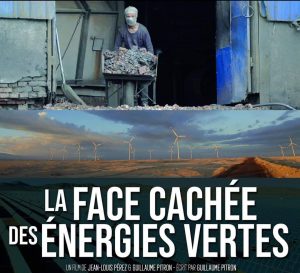Problème de l’individualisme et de la personnalité
Version diaporama de cet article : Personne&Individu
Version un peu plus développée du diaporama avec plus de précisions concernant l’apport de Jacques Maritain : intro1-personne
- L’un des problème majeur de l’homme moderne selon le philosophe Jacques Maritain dans son livre Trois réformateurs, c’est d’avoir confondu l’individualité et la personnalité. Et, cette confusion, l’entraîne dans l’individualisme où, paradoxalement, pensant agir pour obtenir le bonheur, il passe de plaisirs en plaisirs sans obtenir les joies tant recherchées, quant il n’obtient pas finalement douleurs et désespoir ! C’est catastrophique pour les relations aux autres, c’est catastrophique pour notre planète.
- Citation de Jacques Maritain, Trois Réformateurs, p. 27 :
« Voyez avec quelle solennité religieuse le monde moderne a proclamé les droits sacrés de l’individu, et de quel prix il a payé cette proclamation. Et cependant l’individu a-t-il jamais été plus complètement dominé, plus facilement façonné par les grandes puissances anonymes de l’État, de l’Argent, de l’Opinion ? Quel est donc ce mystère ?
Il n’y a là aucun mystère. Le monde moderne confond simplement deux choses que la sagesse antique avait distinguées : il confond l’individualité et la personnalité. »

Qu’est-ce qu’une personne ?
- La personne est « une substance individuelle complète, de nature intellectuelle et maîtresse de ses actions ».
- Une personne est capable de choisir ses fins (ses buts), capable aussi de se déterminer par elle-même aux moyens pour atteindre ses fins, et d’introduire dans l’univers, par sa liberté, des séries d’événements nouveaux.
- En d’autres termes, une personne est capable de décider ce qu’elle veut faire et de se donner par elle-même les moyens de réaliser cette décision. Par l’exercice de cette volonté, elle prend des initiatives : elle initie de nouveaux commencements !
- Thomas d’Aquin précisera que le nom de personne signifie la plus noble et la plus élevée des choses qui sont dans la nature entière : « Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura1 ». Seuls les êtres humains, les anges et Dieu peuvent être des personnes.
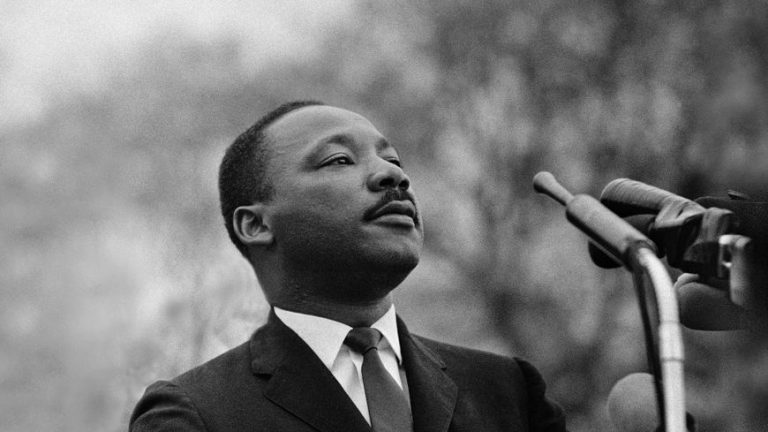
Qu’est-ce qu’un individu ?
- Le nom individu est commun à la bête, à la plante, au microbe et à l’atome : à tout objet.
- L’individualité repose sur les exigences de la matière et de la sensibilité. L’individu subit les forces et les influences du monde. Il réagit plus qu’il n’agit. Il imite plus qu’il n’initie. L’individu humain s’il ne reste qu’un individu se transforme en mouton de Panurge.

- Voyons ce que dit Jacques Maritain p.29 :
« De sorte qu’en tant qu’individus, nous ne sommes qu’un fragment de matière, une partie de cet univers, distincte sans doute, mais une partie, un point de cet immense réseau de forces et d’influences, physiques et cosmiques, végétatives et animales, ethniques, ataviques, héréditaires, économiques et historiques, dont nous subissons les lois. »
- L’individu qui reste individu essaie tant bien que mal de se distinguer des autres individus, parce qu’il veut être reconnu comme différent des autres, se faire un nom. Il recherche telle ou telle originalité sans s’apercevoir qu’il est pris par des réseaux d’influences.
- Il cherche à affirmer sa différence alors même que par nature il est déjà unique et irremplaçable.
Qu’est-ce que l’individualisme ?
- C’est confondre l’individualité et la personnalité. C’est chercher à satisfaire ses désirs et ses envies au gré où ils se présentent sans développer la force de les trier en fonction de ce qui compte réellement pour le développement de notre personne.
- C’est réagir d’abord émotionnellement plutôt qu’utiliser notre raison et notre intelligence.
- C’est ainsi entretenir le côté le plus bas de notre mimétisme et devenir un simple membre de la masse de ceux qui subissent la fabrique du consentement.
- Vouloir développer notre individualité, c’est laisser grandir nos vices alors que nous pourrions développer nos vertus.
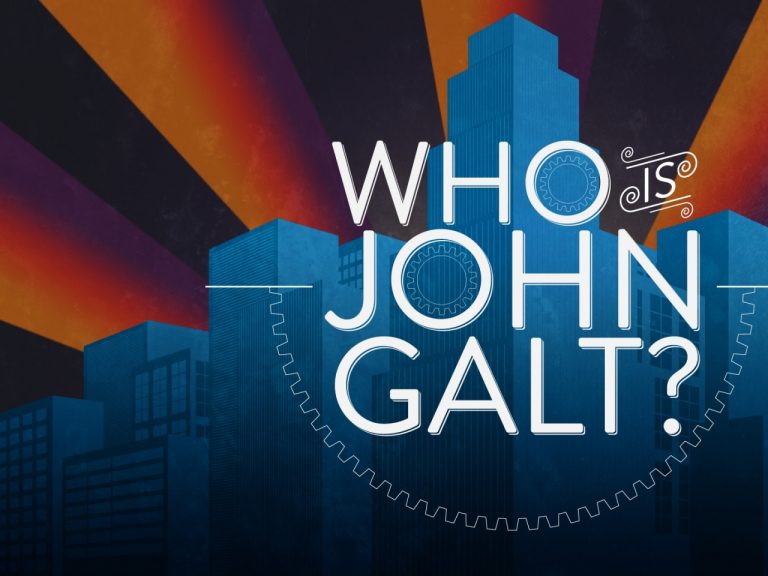
Développement de la personnalité et développement des vertus
Pour réussir à développer sa personnalité, il faut développer ses vertus. Nous n’aurons pas le temps cette année en Éducation Morale et Civique de présenter la doctrine des vertus. Cela fera partie du cours de philosophie de terminale sur le bonheur. Je vous indique juste que la tradition antique reconnaît quatre vertus principales que l’on désigne par l’expression de vertus cardinales. Grâce au philosophe Josef Pieper, nous pouvons les classer ainsi :
- La prudence
- La justice
- Le courage
- La tempérance
Voilà ce qu’il dit p. 19 de son livre Petite anthologie des vertus du cœur humain :
« La vertu est donc, au sens général, l’élévation naturelle de la personne humaine ; elle est comme le dit saint Thomas, l’ultimum potentiae, la réalisation ultime du potentiel humain ; elle est l’aboutissement de tout ce que peut un être humain — dans le domaine naturel aussi bien que dans le domaine surnaturel. L’homme vertueux « est tel » que ses inclinations les plus profondes l’incitent spontanément à accomplir le bien par ses faits et gestes. »

Distinction entre l’intérêt particulier et l’intérêt général
Beaucoup de philosophes modernes présentent le rôle de l’État comme étant au service de l’intérêt général. C’est certainement mieux que de le définir comme étant au service des intérêts d’une minorité ploutocratique comme peut le faire la « philosophe » américaine Ayn Rand, dont se revendique bon nombre de libertariens américains. Cependant, c’est considérer le peuple comme un ensemble d’individus et non comme une communauté de personnes.


Toutefois, s’il fallait distinguer l’intérêt particulier de l’intérêt général nous pourrions dire les choses suivantes :
- L’intérêt particulier désigne les désirs que souhaitent réaliser un individu. Ces désirs ne sont pas forcément bons pour lui ni pour les autres ;
- L’intérêt général représente le calcul mathématique que nous pourrions faire en additionnant les intérêts particuliers des individus. Il est fort à craindre que ce calcul serve finalement les intérêts de ceux qui ont le plus d’argent et qui, grâce à cet argent, peuvent faire plus de lobbying que ceux qui en ont moins.
Distinction entre intérêt bien compris et bien particulier
- Un certain nombre d’auteurs prenant conscience que la notion d’intérêt pouvait apparaître un peu trop égoïste, parlent parfois d’intérêt bien compris. Par là, ils veulent inciter les individus à devenir plus intelligents et à réfléchir aux conséquences de leurs actes dans le temps. C’est un progrès non négligeable et nous pouvons en effet préférer la notion d’intérêt bien compris à celle d’intérêt.
- Cependant, l’origine étymologique du mot intérêt, est très proche du sens du mot « usure ». Par là, il est presque toujours en lien avec la notion de profit, ce qui peut conduire assez rapidement au développement du vice que l’on appelle la cupidité.

- Il me semble donc préférable d’utiliser la notion de bien particulier. On entend par bien particulier, le bien que la personne doit viser pour assurer le développement de sa vie et celle de ses proches.

- C’est la vertu de prudence, en s’appuyant sur toutes les autres vertus, qui permet de trouver ce bien en fonction des circonstances présentes. La prudence dépasse le simple calcul de perte et de profit pour tenir compte de toutes les richesses humaines et particulièrement de celles qui ne relèvent ni du calcul ni de la mesure.

Distinction entre Bien particulier et Bien Commun
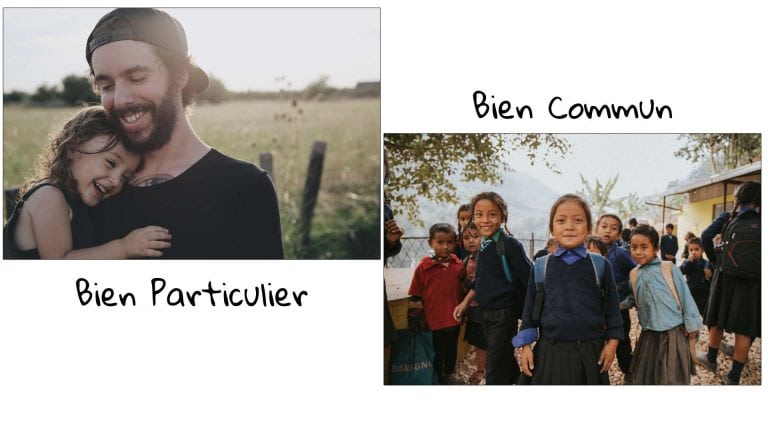
Le bien particulier
- Le bien particulier est centré sur la personne, non pas au sens égoïste du terme mais au sens de ce qui relève de sa responsabilité propre.
- Il vise le développement harmonieux de la personne et de celles qui lui sont confiées.
- Une personne peut décider de renoncer à son bien particulier mais c’est souvent illégitime et dangereux.
- Certains contextes peuvent demander de renoncer à son bien particulier pour assurer le bien commun, mais ces contextes sont rares et ils exigent une grande finesse d’esprit pour décider des risques à prendre de telle manière qu’ils soient vraiment utiles pour le bien.
- Par exemple, pendant la guerre 39-45, certaines personnes se sont investis dans la résistance au péril de leur vie ou de leur réputation. Ils ont renoncé à leur bien propre (parfois jusqu’à leur vie) pour se mettre au service du bien commun.
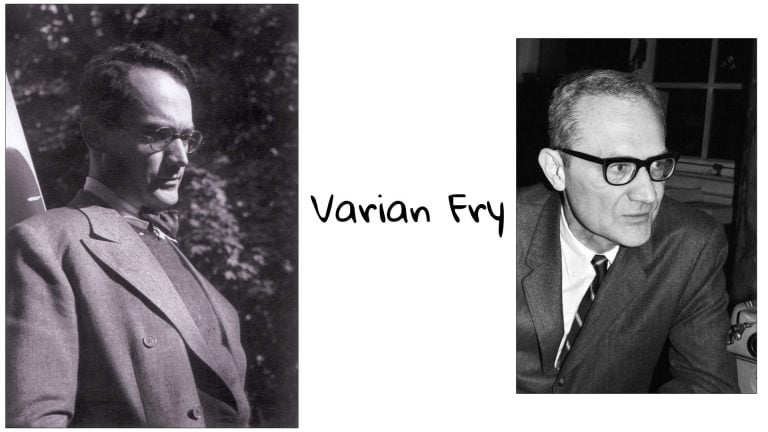
Le bien commun
- Le bien commun ne se confond pas avec l’intérêt général. Ce n’est pas un simple calcul de pertes et profits.
- Le bien commun vise le développement de toutes les personnes concernées, c’est le bien de tous harmonisé avec le bien de chacun.
- En cas de désaccord entre les personnes, il vise à trouver une solution qui soit la plus juste possible pour toutes les personnes concernées, même si évidemment, cela demandera à certaines personnes voire à de nombreuses, de renoncer à certains de leurs désirs.
- Ceci n’est possible que si les personnes prennent conscience que les désirs que nous ressentons ne sont pas forcément de justes désirs ou de bons désirs. Le désir n’est pas un critère suffisant pour juger de ce qu’il faut faire. Nous le verrons dans le cours sur le désir.
- Nous avons besoin de notre conscience morale pour déterminer le bien commun.
- On parle de rationalisation morale de la vie politique.
- L’autorité est justement la qualité requise qui permet de trouver le bien commun en cas de désaccord. C’est pourquoi, nous étudierons cette notion.

Échelle des buts politiques
Il est possible de faire une échelle des buts politiques en partant du but le plus égoïste au but le plus noble. Nous pourrions alors avoir ce classement :
- L’intérêt d’une petite minorité, ce qui en politique pourrait donner une oligarchie ;
- L’intérêt d’une minorité, ce qui pourrait donner une ploutocratie, si cette minorité rassemble les plus riches, ou une aristocratie si cette minorité rassemble les meilleurs (avec tous les problèmes que posent la définition des meilleurs et de la transmission héréditaire ou non) ;
- L’intérêt de la majorité, en tenant compte du fait qu’une majorité relative est très différente d’une majorité absolue. Si la démocratie représentative fonctionne avec la première forme de majorité, il y a de grands risques pour qu’elle ressemble à une sorte de ploutocratie. Une démocratie peut aussi devenir une sorte de dictature de la majorité.
- L’intérêt général, où seules quelques minorités sont lésées, la démocratie pourrait viser cela, mais une monarchie peut aussi le faire.
- Le bien commun, où toutes les personnes sont respectées et où le dialogue entre le pouvoir et le corps politique est régulier pour réussir à discerner ce qui relève du bien commun. La démocratie peut tendre vers ce but, mais une monarchie est aussi possible dans ce but, à condition d’être un régime mixte. Dans l’histoire française peu de monarchies ont fonctionné ainsi (celle de Louis IX ?).

- Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 29, 3. ↩