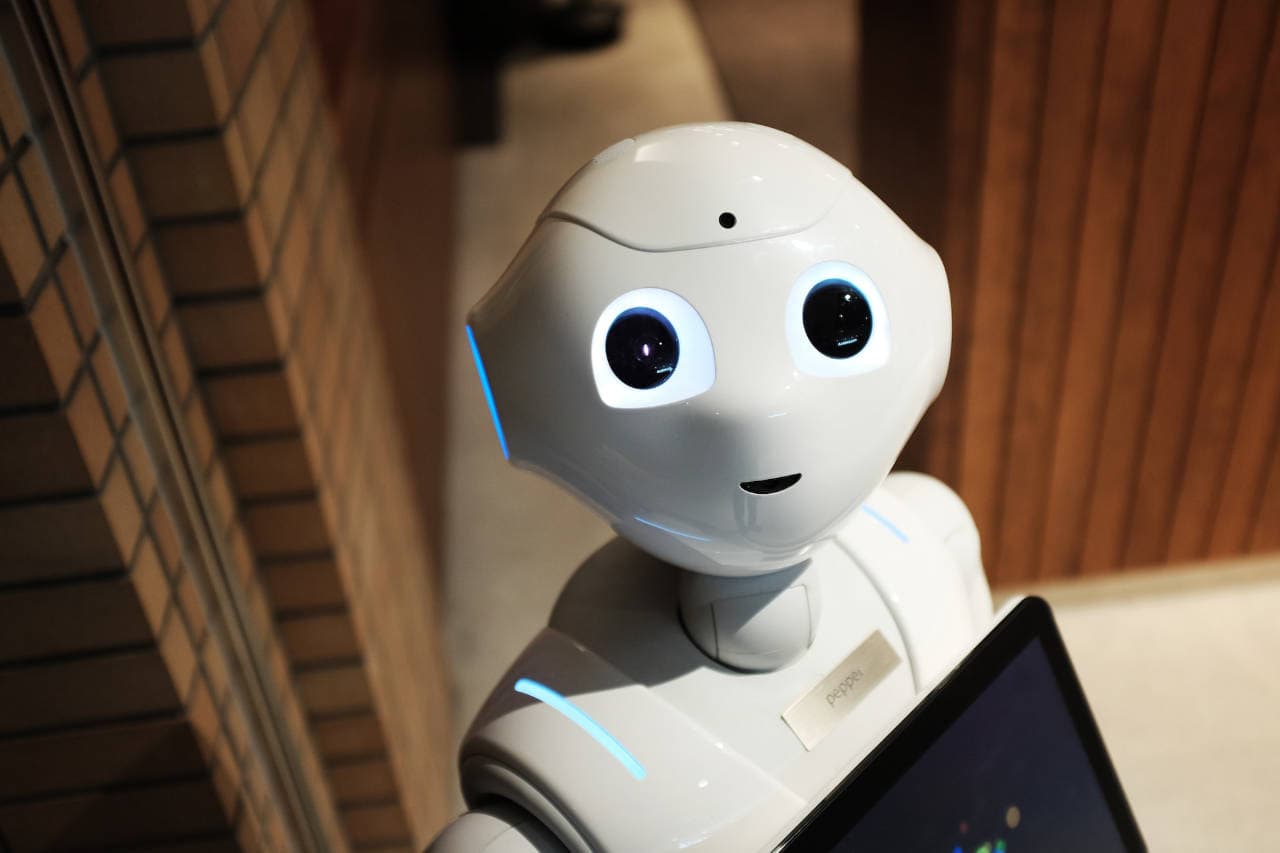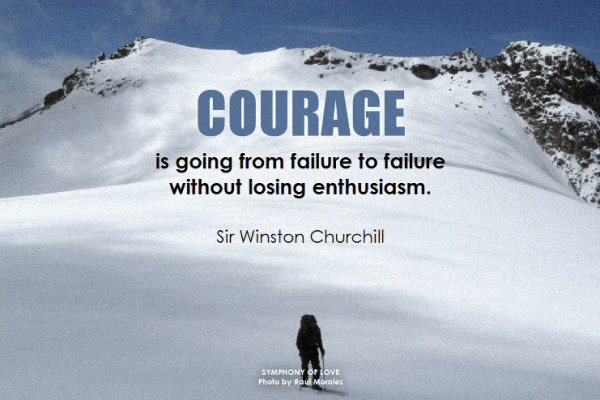Introduction
Cet article est disponible au format pdf ici : L’invention du moi.
Il peut être surprenant de découvrir que le concept de moi n’a pas toujours existé et que son invention est plutôt relativement récente dans l’histoire de la philosophie. Dans cette grande partie intitulée Les métamorphoses du moi, nous avons fait pour l’instant comme si le concept de moi était une donnée première de la philosophie. Pour mieux comprendre ce que nous allons voir aujourd’hui, il est donc bon de nous remettre en mémoire ce que nous avons fait jusqu’ici dans cette partie.
Tout d’abord nous avons vu la conception freudienne du moi, en présentant de manière plus large la conception que Sigmund Freud se faisait de notre psychisme. Je rappelle que psyché signifie âme en grec ancien, et comme l’indique Claude Romano dans le troisième chapitre de son livre L’identité humaine en dialogue, l’âme est considérée par les Grecs anciens comme un principe de vie plutôt impersonnel. Dans la vision du psychisme chez Freud nous avons défini les notions de névroses et de psychoses. Nous avons vu sa seconde topique qui décrit le psychisme humain comme étant composé de trois instances : le Moi, le Ça et le Surmoi. Nous avons aussi rapidement distingué la conscience de l’inconscient, montrant que chez Freud les choses sont plutôt assez complexes. Notons cependant que l’histoire personnelle, et particulièrement l’histoire de la petite enfance de la personne considérée était au cœur de la pensée freudienne. Nous avons terminé le cours sur Freud par la critique faite par le philosophe français naturalisé américain Yves R. Simon. Ce dernier montrait que Freud avait tendance à sous-estimer le fait que l’être humain conserve sa liberté humaine, même s’il reste sous l’influence de son passé. En effet, l’expression freudienne, « le moi n’est plus le maître dans sa maison », même si elle mettait bien en évidence que l’être humain a des difficultés à faire face aux pulsions venant de son corps et qu’il ne fallait donc pas qu’il surestime sa puissance, avait tendance à sous-estimer le fait que l’être humain conserve une réelle puissance qu’il peut dans une certaine mesure développer pour réussir peu à peu à apprivoiser ses pulsions, ses passions, ses émotions.
Nous avons continué en présentant rapidement la critique réalisée par le psychiatre français Henri Baruk concernant les origines de nos névroses et de nos psychoses telles que Freud les envisageait. Nous avons vu que d’une part Freud sous-estimait les causes anatomiques et physiologiques, et que d’autre part il réduisait la conscience morale à n’être que l’intériorisation de l’ensemble des obligations et interdits reçus pendant la petite enfance, intériorisation qui permettait de sublimer le complexe d’Œdipe, et qui en définitive prenait sa source dans la libido de l’enfant. Henri Baruk, fidèle à sa tradition juive, considérait que c’était sous-estimer le rôle de la conscience morale, et que de nombreux conflits intra-psychiques ne sont pas dus à des traumatismes liés à l’enfance, mais simplement à des choix moraux actuels, récents ou passés, incompatibles avec notre nature humaine constituée dès le départ d’un noyau fondamental qu’il appelle justement conscience morale.
Comme dans la tradition judéo-chrétienne d’une part mais aussi dans les cultures grecques et romaines d’autre part, les forces qui nous permettent de mieux écouter en nous ce noyau fondamental s’appellent les vertus, nous avons alors pris le temps de voir l’apport du philosophe Yves R. Simon qui soutient que les Temps modernes ont eu tendance à oublier l’importance des vertus pour leur préférer ce qu’il appelle des substituts modernes des vertus. Yves R. Simon présentait trois substituts modernes des vertus :
- La « Bonté Naturelle » de Jean-Jacques Rousseau et de Ralph Waldo Emerson ;
- L’« Ingénierie Sociale » de Charles Fourier qu’on peut comparer à celles de ses successeurs ;
- Les psycho-technologies développées à la suite de Sigmund Freud.
Ceux qui voudraient découvrir plus amplement les différentes vertus peuvent consulter mon cours sur le bonheur dont le diaporama sur les vertus, ainsi que ma première introduction du cours des terminales.
Maintenant, je vais essayer de mettre en évidence l’une des origines possibles de cet oubli des vertus. J’émets l’hypothèse que cet oubli peut venir de l’apparition d’une conception égologique de notre personnalité suite à l’invention faite par René Descartes du concept de moi. J’opposerai ensuite dans le cours suivant des conceptions dialogiques de notre personnalité à ces conceptions égologiques. Pour mettre en évidence ces manières très différentes d’envisager notre personnalité, j’utiliserai alors essentiellement trois philosophes du XXème siècle : Emmanuel Lévinas, Jean-Louis Chrétien et Emmanuel Housset. Gardons en mémoire cependant que les conceptions dialogiques de la personne ne rejettent pas forcément toutes les caractéristiques des conceptions égologiques. Disons plutôt qu’elles tiennent compte de leurs apports et de leurs défauts.
Dans ce cours nous allons donc nous intéresser à l’invention du concept de moi telle que l’a faite René Descartes. Nous avons, à ma connaissance, deux philosophes contemporains français qui ont mis en évidence cette invention. Le premier s’appelle Vincent Carraud, il est né en 1957, il est professeur d’histoire de la philosophie moderne à la Sorbonne Université, il décrit cette invention dans son livre précisément intitulé L’invention du moi, publié pour la première fois en 2010 et réédité en 2021. Vincent Carraud soutient que même si à l’époque de René Descartes et de Blaise Pascal, c’est-à-dire au XVIIème siècle on a plutôt tendance à parler du moi de Monsieur Pascal, Blaise Pascal lui-même n’a pu substantiver le moi que pour rejeter la substantialisation du moi faite par René Descartes.
Le second philosophe qui s’intéresse à cette invention du moi, c’est le philosophe Claude Romano, qui est né en 1967 et qui est maître de conférence à l’université Paris-Sorbonne et professeur au département philosophie de l’université catholique australienne. Il s’intéresse plus particulièrement à l’invention du moi dans son livre publié en octobre 2022 intitulé L’identité humaine en dialogue dont il en fera le titre de son deuxième chapitre. Je m’appuie sur ce chapitre ainsi que sur le suivant pour réaliser la suite de ce cours.
L’apparition datée du concept de moi
Comme je l’ai déjà dit, même si Vincent Carraud soutient que le moi comme substantif, c’est-à-dire comme nom commun et non plus comme pronom personnel d’insistance, est plutôt attribué au XVIIème siècle et encore au XVIIIème à la paternité de Blaise Pascal, il précise que c’est bien à René Descartes auquel Blaise Pascal pense quand il écrit au sujet du moi, même s’il ne l’envisage pas vraiment à la manière de René Descartes. Cependant, comme Claude Romano nous le montre, dans l’histoire de la philosophie et dans l’histoire plus générale des idées, c’est bien le concept de moi mis en évidence par René Descartes qui va servir de point de départ de multiples débats dans le monde moderne. Rappelons donc les dates de nos deux initiateurs de l’utilisation du nouveau substantif le moi : René Descartes est né en 1596 et mort en 1650, tandis que Blaise Pascal est né en 1623 et mort en 1662. Vincent Carraud soutient d’ailleurs que Blaise Pascal aurait été l’un des premiers « cartésiens » même si sa pensée diffère grandement de son maître, particulièrement quant au statut du moi.
Claude Romano remarque que plusieurs philosophes contemporains ont bien essayé de trouver des précurseurs dans l’Antiquité ou au Moyen-Âge au concept de moi mais toujours en exagérant ou en déformant ce que disaient les Anciens. Il est donc bon de retenir que la paternité du concept de moi tel qu’il est apparu en philosophie moderne est due à René Descartes. Il ajoute que la conception du moi chez René Descartes est très différentes de celle de Blaise Pascal :
- René Descartes considère le moi comme une res cogitans c’est-à-dire une chose pensante ou un sujet pensant. Ce sujet pensant est réellement distinct de son corps, de son composé psycho-physique, de ce qu’il est en tant qu’homme, bref de son histoire personnelle. Il fait du moi une substance à part entière, mais une substance pensante. Je rappelle que pour comprendre la notion de substance, il faut la distinguer de ce qu’Aristote appelle les accidents. Le mot substance traduit le mot grec ousia, et pour Aristote, il désigne un noyau d’être distinct, capable de subsister et d’être défini à part. Je renvoie ceux qui voudraient bien comprendre la distinction entre substance et accident au chapitre II du livre d’Étienne Gilson, L’Être et l’Essence (1972, réédité en 2008).
- Pour Blaise Pascal, le moi n’est pas une substance, ni un pur sujet pensant, il renvoie plutôt à une attitude, qui est une conséquence du péché originel, et qui consiste à se faire centre de tout. Pour lui, le moi est un autre nom pour l’amour-propre (voir Pensées, 100 dans le classement Lafuma), racine de toute injustice, et c’est la raison pour laquelle Blaise Pascal préconise son anéantissement pur et simple (voir Pensées 492).
Le concept de moi apparaît chez Descartes d’abord dans la 4ème partie de son Discours de la méthode publié en 1637, avec sa célèbre formule que nous allons voir : « je pense donc je suis », en latin, cogito, ergo sum. Il la développera à nouveau et de manière un peu différente en 1641 dans la méditation seconde de ses Méditations métaphysiques ou Méditations sur la philosophie première : « je suis, j’existe », en latin, ego sum, ego existo. L’apparition du concept de moi est donc bien datée et localisée, elle date du XVIIème siècle et précisément de l’année 1637 en France.
Remarquons cependant que dans la formule de 1637, le mot « moi » n’apparaît pas explicitement, c’est le concept de moi qui y trouve sa naissance même s’il n’est qu’implicitement présent dans le mot « je » sous-entendu dans la conjugaison latine des deux verbes. En revanche, dans la formule de 1641, le pronom personnel « ego » est bien présent, il peut aussi bien se traduire par « je » ou par « moi ».
Ce qui nous intéresse maintenant ce n’est pas directement le texte de René Descartes, mais l’analyse que Claude Romano en fait pour caractériser le concept de moi chez Descartes, concept qui va influencer les réflexions modernes à ce sujet et qui, selon lui, permettent de circonscrire le domaine des égologies. Cependant, comme le texte du discours de la Méthode introduit la formule, je vous le distribue. Je vous mets aussi à disposition sur Trello, le texte correspondant de sa méditation seconde pour que vous puissiez voir les différences entre les deux approches faite par Descartes. Voyons maintenant les quatre caractéristiques que Claude Romano attribue au concept de moi chez Descartes et qu’il résume à la fin du deuxième chapitre de son livre L’identité humaine en dialogue, dont je vous mets aussi le texte à disposition.
Les quatre caractéristiques du concept de moi chez Descartes
- Le moi ne prend forme que sur l’arrière-plan de l’objectivation de la nature hors de nous et en nous ;
- Le moi est l’esprit donné à lui-même en première personne ;
- Le moi est un processus qui s’accompagne inévitablement d’un processus d’objectivation de soi ;
- Le moi serait le lieu de mon identité véritable, mon identité en tant que sujet.
Je développerai plus dans ce cours la première caractéristique que les autres car Claude Romano met en évidence deux distinctions conceptuelles à l’occasion de cette présentation qui nous seront utiles quand il s’agira de distinguer une conception dialogique du moi par rapport à une conception égologique du moi.
Le moi ne prend forme que sur l’arrière-plan de l’objectivation de la nature hors de nous et en nous
Modernisation du concept d’objectivité
« La mise au point de la conceptualité égologique découle de la nouvelle image de la nature qui s’est imposée à la suite de la révolution galiléenne. » (Claude Romano, IHED, chap. 2, p. 42)
La révolution galiléenne dont nous avons déjà parlé l’année dernière ne consiste plus à considérer les êtres minéraux et les êtres vivants de la même manière qu’auparavant. Elle ne s’intéresse pas tant à ce qui constitue leur nature en propre, mais plutôt à l’ensemble des systèmes matériels en mouvement relatif les uns par rapport aux autres dans l’espace infini, pour autant qu’ils se prêtent à une détermination rigoureuse au moyen de la mesure et du calcul. En effet, ce qui intéresse Galilée et ses successeurs chez les êtres naturels, c’est surtout ce que l’on peut mathématiser. Comme le dit Galilée, une telle nature, est « écrite en langage mathématique ». Claude Romano soutient que cette nouvelle vision mathématique du monde change le concept d’objectivité qui prend alors un nouveau sens. Il y a donc un sens ancien qui reste valable et un sens moderne du concept d’objectivité :
- Le sens ancien d’objectivité désigne ce qui est vrai indépendamment de nos croyances et se prête à un accord sur la base des normes de la rationalité universelle, c’est-à-dire de ce qu’on désigne traditionnellement par les principes de la raison, dont les 5 plus importants sont :
- Le principe d’identité ;
- Le principe de non-contradiction ;
- Le principe du tiers-exclu ;
- Le principe de rationalité ;
- Le principe de causalité.
- Le sens moderne d’objectivité désigne alors ce qui peut être connu au moyen de la mesure et du calcul, et qui se prête à une mise en forme mathématique. D’ailleurs, la tentation est grande aujourd’hui de croire que la raison se limite à la puissance de calculer. On finit par croire que la logique, c’est-à-dire la science du raisonnement, ne serait qu’une branche des mathématiques, alors qu’elle porte sur un domaine de connaissance qui possède à la fois des points communs et des différences.
De l’apparition de cette nouvelle forme d’objectivité, Claude Romano en déduit la chose suivante :
Il en découle un grand partage, une grande ligne de faille qui sépare désormais la nature « objective », exprimable en langage mathématique, du théâtre d’ombres de notre expérience naïve, entachée de subjectivité. L’univers ayant été réduit à un domaine d’objets unifiés par des lois mathématiques, toute la sphère des significations pratiques qui peuplent notre monde quotidien et rendent par exemple certaines choses « attirantes » ou « repoussantes », « propices » ou « défavorables », « rassurantes » ou « inquiétantes » doivent être réservées au compte de simples apparences et tenues pour des anthropomorphismes. Le monde est ainsi expurgé de toutes ses significations, des fins et des valeurs qu’il recèle ; il perd le caractère d’une unité finalisée, d’un ordre, d’un cosmos, pour se réduire à « un ensemble ouvert lié par l’unité de ses lois1. (Claude Romano, IHED, p. 44)
Il ajoute à la ligne suivante :
Mais c’est aussi le sujet qui contemple cet univers qui se voit dépouillé de ses traits contingents pour revêtir le statut d’un pur sujet de connaissance placé en face d’un pur domaine d’objets.
Par ses traits contingents, il serait sans doute préférable de dire ses traits personnels, c’est-à-dire ce qui fait de lui une personne unique et totalement différente des autres personnes. De toute façon, il est normal qu’en substantivant un pronom personnel (= en le transformant en nom commun) qui sert normalement à désigner la personne qui parle, on aboutisse à ne conserver que ce qui est commun à tous les humains. C’est d’ailleurs pourquoi notre langue différencie les noms communs des noms propres. Les noms communs nous apprennent certes quelque chose sur les choses désignées, mais seulement ce qui est communicable, c’est-à-dire ce que nous pouvons nous transmettre en commun. Un nom propre ne nous communique rien, sauf à penser que l’étymologie du nom ou du prénom décrit la personne désignée. Un nom propre désigne une personne, il ne la décrit pas. Le rôle d’un pronom personnel dans le langage courant sert justement à désigner la personne qui parle et donc à tenir lieu de remplaçant du nom propre, non à nous fournir une connaissance commune donc communicable sur cette personne qui parle.
Claude Romano en conclut dans la phrase suivante cette chose essentielle pour comprendre d’où peut venir l’oubli de l’importance des vertus :
L’univers est dès lors dépossédé de toute sa texture sensible et phénoménale, de toutes ses qualités qui échappent à une mise en forme mathématique.
Il y a le risque de ne plus prendre en compte à côté de nos particularités personnelles, ce qu’avec Thomas d’Aquin on peut appeler nos inclinations naturelles, c’est-à-dire nos émotions. Or ces émotions sont une source d’informations concernant notre lien avec réel. Les émotions sont en effet ce qui nous permet de saisir immédiatement ce qui est attirant (désir ou espoir) ou repoussant (peur ou dégoût), propice (amour) ou défavorable (haine), rassurant (amour, désir, plaisir, joie) ou inquiétant (haine, peur, douleur ou tristesse). Les émotions échappent évidemment à la mathématisation du réel, cependant elle n’échappe pas à la reprise par l’intelligence humaine puisque la vertu de tempérance, c’est justement la force morale qui va permettre de modérer les actes de notre corps sous l’influence des émotions en suivant les conseils de l’intelligence pratique, la phronésis, c’est-à-dire la vertu de prudence. Autant une personne qui écoute trop ses émotions, c’est-à-dire une personne qui manque de tempérance, peut en effet finir par s’oublier elle-même et par s’aliéner, autant définir le moi sans tenir compte de ses particularités personnelles ainsi que de ses émotions, c’est renoncer à ce qui fait d’un moi, un moi humain.
Et, même si Freud tiendra en partie compte des émotions par l’intermédiaire de sa notion de pulsion, le fait qu’il ait tendance à réduire les pulsions à la pulsion de vie (la libido) et à la pulsion de mort, appauvrit grandement la richesse de la conception thomiste qui distinguait le concupiscible de l’irascible. Heureusement, dans l’histoire des idées, les choses sont complexes, et nous ne manquons pas aujourd’hui de courants de psychologie qui essaient de réhabiliter la place des émotions dans la connaissance de la spécificité humaine. Il reste cependant une certaine tendance toujours présente d’en faire des processus matériels et peut-être en dernier recours modélisables par des simulations informatiques (Intelligence Artificielle), bref par des modèles mathématiques. De toute façon, la plupart des écoles psychologiques actuelles ne parlent plus de l’apprivoisement des inclinations naturelles, de leur maîtrise, comme le diraient les Anciens, c’est-à-dire des vertus.
Intériorité faible et intériorité forte ou intériorité ouverte et intériorité forclose.
Claude Romano ajoute :
Cette nouvelle image de la nature entraîne l’éviction de l’esprit de cette même nature par un processus d’abstraction analogue à celui appliqué aux objets matériels pour en éliminer tous les reliquats de la subjectivité. (Claude Romano, IHED, p. 45).
Le moi ainsi considéré est, comme nous l’avons déjà remarqué, dépouillé de ses particularités, de son histoire personnelle, de son tempérament et de son caractère. Le moi n’est alors rien d’autre qu’un ensemble de pensées et de représentations, une sorte de pur sujet de la connaissance objective (au sens moderne). Il devient un absolu, une substance « qui n’a besoin de rien d’autre pour exister, comme le dit Descartes.
Claude Romano soutient alors qu’un nouveau concept d’intériorité apparaît, et il va distinguer l’ancien concept d’intériorité qu’il appelle intériorité faible avec une nouvelle forme d’intériorité qu’il appelle intériorité forte :
- L’intériorité faible, c’est le fait que même si la personne peut se replier en elle-même pour penser, réfléchir, sentir ou imaginer, son âme continue de faire partie de l’ordre cosmique et reste donc constamment en lien et en dialogue avec lui. Elle « pouvait même accueillir en elle une altérité — un daimon ou le Deus interior intimo meo d’Augustin ». Je préfère désigner ce type d’intériorité par l’expression intériorité ouverte pour préparer l’idée que notre identité personnelle est plutôt une identité dialogique. Une identité dialogique, c’est une identité qui grandit en elle-même grâce aux différents dialogues réalisés dans notre vie, que ce soit grâce aux personnes que nous rencontrons avec les dialogues dissymétriques mis en évidence par Emmanuel Lévinas, ou grâce au dialogue intérieur cher à Hannah Arendt reprenant Socrate, ou aux dialogues avec notre Créateur cher à Augustin qui se concrétise par la contemplation, la prière ou l’oraison.
- L’intériorité forte, est ce nouveau concept initié par René Descartes, où l’esprit a une conscience immédiate de ses représentations et il n’y a plus de place pour le doute et l’erreur s’il réussit à être bien attentif à lui-même. Claude Romano concède que Descartes reste à mi-chemin entre cette nouvelle manière d’envisager l’intériorité et l’ancienne car il reconnaît la présence en elle d’une Idée qui ne vient pas directement d’elle-même mais de Dieu, et c’est l’idée d’infini. Cependant, à la différence de l’ancienne intériorité qui envisageait un dialogue avec Dieu chez Augustin, par exemple, il ne s’agit plus d’un dialogue avec le créateur mais seulement de la présence d’une idée d’origine extérieure. Il ajoute : « Clos sur lui-même en vertu de l’absolue certitude de ses idées, l’esprit se définit déjà par ce que Husserl appellera par la suite sa “clôture égologique” ». C’est pourquoi, je préfère appeler cette intériorité forte, intériorité forclose reprenant un vocabulaire qui me vient du livre du philosophe Jean-Louis Chrétien dont je vous reparlerai, L’espace intérieur. Remarquons d’ailleurs que Claude Romano cite explicitement aussi Jean-Louis Chrétien dans ce même livre.
Le moi est l’esprit donné à lui-même en première personne
Le moi se définit essentiellement par la relation en première personne qu’il entretient à lui-même. Alors que dans l’Antiquité avec un philosophe comme Aristote, l’Ami, c’est-à-dire l’ami véritable, était celui qui pouvait le mieux me connaître. La personne concernée n’était pas la mieux placée pour se connaître avec certitude : à l’image de son œil qui ne peut s’apercevoir lui-même que dans le reflet de la pupille de son ami, elle ne peut pas directement s’apercevoir elle-même tant il est facile pour elle de se tromper sur elle-même. Dans l’Antiquité donc, même si le concept de moi n’existait pas vraiment, il aurait été cependant facile de dire que le moi est le moins bien placé pour être objectif (au sens ancien) sur lui-même.
Avec Descartes, la relation à soi est une relation privilégiée du point de vue de la connaissance. L’ego, le moi possède une certitude absolue de son existence (ce que n’aurait sans doute pas renié les Anciens) ainsi que du contenu de ses pensées (ce qui aurait été sans doute beaucoup plus discuté). Chez Descartes, cette relation privilégiée reste une relation de connaissance. Claude Romano nous indique qu’un philosophe comme Fichte ira plus loin que Descartes puisqu’il ira jusqu’à dire que le moi « se pose lui-même ». On retrouve en un sens la notion d’identité de projet dont je vous avais parlé en début d’année dans le cours sur l’identité personnelle.
Le moi est un processus qui s’accompagne inévitablement d’un processus d’objectivation de soi
Dans cette troisième caractéristique de ce concept de moi, Claude Romano met en évidence un paradoxe. Le moi est à la fois ce concept qui désigne le fait que la personne se désigne en tant que sujet et donc en tant qu’elle est au centre de ses perspectives sur le monde, mais en étant substantivé sous le nom commun « le moi », il se dépouille aussi de toutes ses particularités, de tout ce qui fait son identité personnelle, son corps, son tempérament, ses origines, etc. Nous aboutissons alors à un processus d’objectivation de nous-mêmes qui passe forcément à côté de ce que l’on appellera plus tard notre différence personnelle. Ce processus est paradoxal car il crée une sorte de centre de perspective distinct de toutes nos particularités, une sorte de noyau pur de simple puissance de connaissance, mais tout en continuant de porter la trace d’une certaine personnalisation en raison de son ancien statut de pronom personnel de la première personne.
Le moi serait le lieu de mon identité véritable
Pour alourdir encore plus l’épaisseur du paradoxe mis en évidence un peu plus haut, le moi ainsi définit se retrouve privé de tout ce qui fait sa particularité personnelle, c’est-à-dire son corps, son tempérament, son caractère, ses origines, etc. Il se retrouve donc comme dépersonnalisé. Pourtant, en même temps, mon identité véritable ne serait accessible qu’en première personne et donc que grâce à lui. Je ne pourrais donc me connaître que grâce à ce moi où je suis le sujet de toutes les perspectives que je peux avoir sur le monde et sur moi-même, et en même temps à condition de renoncer à tout ce qui constitue mon individualité propre.
Dès que les autres pourraient contribuer à déterminer ce que je pourrais être, ils me feraient retomber dans le statut d’être un objet parmi le monde des objets et manqueraient alors inévitablement ma particularité de sujet, c’est-à-dire de moi pensé comme centre de perspectives. Selon Claude Romano, le philosophe John Locke ira encore plus loin que Descartes qui initiait seulement ce mouvement, en distinguant deux self. Un self dont l’identité réside dans la continuité de sa vie, et qui donc tient compte des particularités de cette vie, et un self qui devient, sinon détachable de toute incarnation humaine, du moins séparable d’une incarnation humaine déterminée. Ce deuxième self serait une sorte de pure conscience de soi détachée de cette incarnation présente. Cela rejoint d’ailleurs les différentes expériences de pensée que Locke développe autour de la métempsychose.
Conclusion
Avec René Descartes, une nouvelle conception du moi s’initie. Elle va se développer dans les siècles qui suivent dans différentes conceptions égologiques du moi. Nous verrons dans le prochain cours qu’il existe aussi d’autres manières d’envisager le moi humain, manières que nous pouvons désigner par l’expression : les conceptions dialogiques du moi. Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer complètement à cette notion de moi, cela veut dire plutôt qu’il est bon de lui apporter des nuances pour réussir à bien identifier la véritable nature de la personnalité humaine. L’enjeu est important car il entraîne non seulement des manières différentes de se comporter avec soi, mais aussi de se comporter avec les autres. Les conceptions égologiques du moi sont porteuses de multiples égoïsmes et finalement peu compatibles avec une fraternité incarnée. Ce n’est donc peut-être pas un hasard si la philosophie de John Locke, l’un des pères du libéralisme, est aussi une géophilosophie de la servitude comme le soutient le philosophe contemporain Matthieu Renault dans son article publié dans le magazine Chimère 2015/1, pp. 23 à 30. John Locke défendait l’existence d’un self comme pure conscience de soi, détachée de cette incarnation présente, et en même temps qu’il se disait libéral, il était l’un des principaux investisseurs de la Royal African Company, pilier du développement de la traite négrière.
- Alexandre Koyré, Études galiléennes, Paris, Hermann, 1966, p. 165. ↩